

L’art « anthropocène », pas si facile. Article réservé aux abonnés Quand les impressionnistes peignaient la nature, celle-ci n’était encore pas menacée par l’industrialisation galopante.
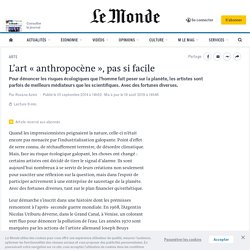
Point d’effet de serre connu, de réchauffement terrestre, de désordre climatique. Mais, face au risque écologique galopant, les choses ont changé : certains artistes ont décidé de tirer le signal d’alarme. Ils sont aujourd’hui nombreux à se servir de leurs créations non seulement pour susciter une réflexion sur la question, mais dans l’espoir de participer activement à une entreprise de sauvetage de la planète. Avec des fortunes diverses, tant sur le plan financier qu’esthétique. Leur démarche s’inscrit dans une histoire dont les prémisses remontent à l’après- seconde guerre mondiale. Actuellement à l’affiche du Cent Quatre à Paris, le couple d’artistes britannique Ackroyd et Harvey réfléchit depuis plus de vingt ans à la question de la germination, sur les brisées de ces grands prédécesseurs. Renaissance sauvage.
C'est un livre étrange que nous commentons aujourd'hui.
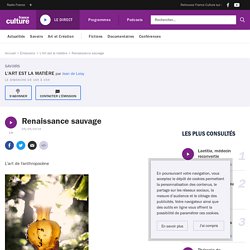
Un livre savant certainement et dont l'objet, assez clair au fond, est dans l'air du temps. Etablir une nouvelle alliance avec le cosmos pour parvenir à une nouvelle renaissance. Composer une relation dans lequel le vivant, le politique et les cosmique seraient alliés et non plus instrumentalisés par l'homme. La renaissance sauvage, l'art de l'anthropocène, est un livre militant, politique mais aussi un livre d'histoire de l'art et d'histoire des sciences où sont commentées les oeuvres de Léonard de Vinci, ou du baroque de bohème, aux artistes d'avant-garde comme Saraceno ou Olafur Eliasson et où l'on voit intervenir par moment des physiciens et des philosophes. Et pourtant ce travail est inspiré par la poésie et tout du long celle-ci flotte en contrepoint curieux que dessine Guillaume Logé... Avec Guillaume Logé et Dominique Bourg Lectures par Thierry Gibault.
La Crypte d’Orsay. "Faire des cabanes donc : braver les destructions, les expulsions et les laideurs, prendre l’air, en finir avec la fin du monde.

Écouter pour cela toutes les idées du monde — les idées qu’a le monde, les idées qu’ont les choses, qui n’en manquent pas — et les suivre, s’en remettre à elles, soutenir les vies qui s’essaient, tenter des liens, repousser, faire avec toutes sortes de vivants. » Marielle Macé, Nos cabanes, édition verdier, 2019. Le quinzième jour, Hiroshima se couvrit de fleurs. Sur les cendres radioactives se mirent à pousser bleuets, glaïeuls, volubilis et belles d’un jour, avec une vigueur inconnue jusque-là. On dit que la chaleur de la bombe, identique à celle du soleil, libéra des graines fossilisées, en latence depuis des milliers d'années. Il n’y aura donc peut-être pas de fin, du moins pas celle que l’on croit, mais reste la nécessité de (re)trouver comment fleurir les terres brûlées et dynamiser les sols où nous poussons.
Les visions apocalyptiques dans l’art. La vision apocalyptique dans l’art remonte aux représentations de l’enfer entre autres.
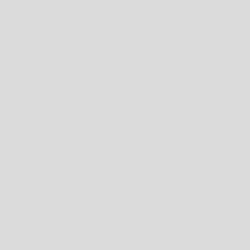
Le Moyen-âge est une période florissante pour ce genre de représentations. La plupart des religions admettent l’existence d’esprits démoniaques ou malfaisants mais le diable reste une création du christianisme. Raoul Glaber est le premier, au début du XIe siècle, à décrire le diable issu d’un de ses songes comme un « être de petite taille, la peau ridée, un visage difforme, le crâne allongé avec un museau de chien et des oreilles hérissées, une barbe de bouc, des griffes, les cheveux sales et raides, les dents d’un chien, une bosse sur le dos, les fesses pendantes, les vêtements malpropres. » Wikipédia Il écrit comme une sorte de témoignage de sa rencontre avec le diable pour donner plus de crédit à ses propos: » Une nuit se dresse devant moi une sorte de monstre terrible à voir.
Plus tard, Colette écrit un passage sur le diable : « Je suis le diable. Land Art post-apocalyptique. Inquiétant, ce drapeau qui flotte au vent, planté au milieu d’un désert étouffant.
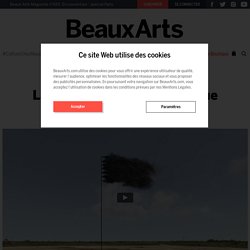
On se demande bien de quelle obscure nation cet étendard de fumée noire est le symbole, mais ce dont on est sûr, c’est qu’il n’annonce rien de bon… Et pour cause, située sur le lieu du premier gisement de pétrole, découvert en 1901, à Spindletop au Texas et marquant la naissance de l’industrie pétrolière, cette bannière est celle de l’exploitation sans relâche des combustibles fossiles et de la destruction environnementale qui en résulte depuis plus d’un siècle. À l’occasion du World Earth Day en avril dernier et à la demande de Channel 4, l’artiste irlandais John Gerrard a ainsi matérialisé et transposé dans la cour de la Somerset House à Londres son funeste symbole. Western Flag est constitué de milliers de photographies du site du Texas, aujourd’hui abandonné, assemblées puis retransmises pour simuler une diffusion en temps réel à laquelle s’ajoute le drapeau réalisé en 3D.