


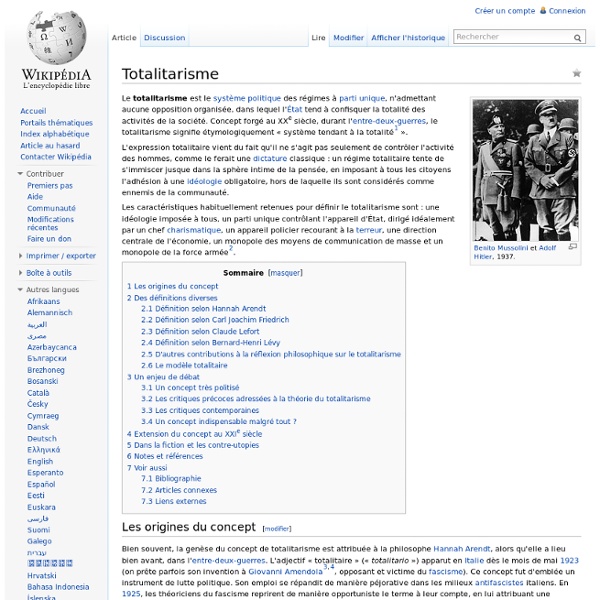
Totalitarisme "Toupictionnaire" :Le dictionnaire de politique Définition du totalitarisme Etymologie : dérivé de totalité, du latin médiéval totalis, du latin totus. Le totalitarisme désigne un mode de gouvernement, un régime politique dans lequel un parti unique détient la totalité des pouvoirs et ne tolère aucune opposition (monopartisme), exigeant le rassemblement de tous les citoyens en un bloc unique derrière l'Etat. Le totalitarisme est un mode de fonctionnement de l'Etat dans lequel celui-ci prétend gérer, outre la vie publique, la vie privée des individus (régime policier, encadrement de la jeunesse et des relations professionnelles...). Le totalitarisme est une des formes de despotisme apparue au XXe siècle. Exemple de régimes totalitaires : Le fascisme italien, Le national-socialisme allemand, Le régime stalinien (cf. >>> Terme connexe : Autoritarisme >>> Terme connexe : Culte de la personnalité >>> Terme connexe : Despotisme >>> Terme connexe : Fascisme >>> Terme connexe : Parti unique
Antisémitisme antisémitisme est la discrimination et l'hostilité manifestées à l'encontre des Juifs en tant que groupe ethnique, religieux ou supposément racial. Étymologiquement, ce terme pourrait s'appliquer aux peuples sémites parlant l’une des langues sémitiques (comme l'arabe ou l'amharique) mais il désigne en fait, dès sa formulation vers la fin du XIXe siècle, une forme de racisme à prétentions scientifiques et visant spécifiquement les Juifs[1]. Les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme incluent divers préjugés, des allégations, des mesures discriminatoires ou d’exclusion socio-économique, des expulsions, des massacres d’individus ou de communautés entières. Le terme « antisémitisme » et ses dérivés apparaissent en Allemagne à la fin du XIXe siècle bien que les faits qu’ils décrivent soient plus anciens. Le mot « Antisemitismus » traduit ici par« antisémitisme » est introduit dans le discours politique en 1879 par le journaliste allemand Wilhelm Marr. Alexandre le Grand (356 - 323 av.
Fascisme Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le terme fascisme s'applique au sens étroit à la période mussolinienne de l'histoire italienne et au sens large à un système politique aux caractéristiques inspirées par l'exemple italien mais qui a pu prendre des aspects différents selon les pays. Des débats existent entre les historiens quant à la qualification de certains régimes (France de Vichy, Espagne franquiste[1]...). Niant l'individu et la démocratie au nom de la masse incarnée dans un chef providentiel, le fascisme embrigade les groupes sociaux (jeunesse, milices) et justifie la violence d'État menée contre les opposants assimilés à des ennemis intérieurs, l'unité de la nation devant dépasser et résoudre les antagonismes des classes sociales dans un parti unique. Idéologie[modifier | modifier le code] Il se définit lui-même comme « totalitaire », et peut se résumer par une formule de Mussolini : « Tout par l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État !
Les furies d'Hitler, ces femmes nazies aussi cruelles que les hommes Temps de lecture: 2 min Qui aujourd’hui a entendu parler des furies d’Hitler? Presque oubliées par l'histoire, ces femmes nazies doivent être prises très au sérieux et ne pas être considérées comme des anomalies. «Ce n’était aucunement des sociopathes marginales», avertit Wendy Lower, auteure du livre Hitler’s Furies: German women in the nazi killing fields (Les furies d’Hitler: les femmes allemandes sur les champs de tuerie nazis) dans un article pour le Daily Beast. Bien que les exemples documentés de mise à mort directe ne soient pas nombreux, comme leur pendant masculin, elles croyaient en la justesse de leur cause. Dans son livre, Wendy Lower relate notamment un «épisode» survenu le 16 septembre 1942 dans la ville de Volodymyr-Volynskyï, à la frontière entre l’Ukraine et la Pologne. «Elle s’approcha de deux enfants juifs, l’un âgé de six ans et l’autre encore bambin qui vivait près du mur du ghetto. Des histoires similaires, Wendy Lower en a tristement beaucoup à raconter.
Marronnier (journalisme) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Un marronnier en journalisme est un article ou un reportage d'information de faible importance meublant une période creuse, consacré à un évènement récurrent et prévisible. Tout comme le marronnier (l'arbre) qui invariablement, tous les ans, produit ses fruits, le marronnier journalistique reproduit les mêmes sujets avec plus ou moins d'originalité. La qualité première du marronnier est qu'il n'est jamais rédigé dans l'urgence, puisque sa parution est programmée d'une année sur l'autre. Tous les ans, aux premiers jours du printemps, un marronnier rose fleurissait sur la tombe des Gardes suisses tués lors de la journée du 10 août 1792, dans les jardins des Tuileries à Paris ; et tous les ans un article paraissait dans la presse pour s'en faire l'écho[2]. Certains sujets, sans être réellement saisonniers, peuvent être « resservis » chaque année pour améliorer le tirage en période d'actualité creuse.
État policier Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Un État policier se distingue spécifiquement par ses caractéristiques totalitaires ou l'utilisation de moyens radicaux pour assurer le contrôle social. Dans un tel État, la police n'est pas soumise aux règles de l'État de droit. Dans une république bananière, les autorités de répression permettent le maintien d'une économie palatine sur le plan du modèle économique, sans contestation de la population sauf au travers d'un sanglant renversement de régime. « L'État de police est celui dans lequel l'autorité administrative peut, d'une façon discrétionnaire et avec une liberté de décision plus ou moins complète, appliquer aux citoyens toutes les mesures dont elle juge utile de prendre par elle-même l'initiative, en vue de faire face aux circonstances et d'atteindre à chaque moment les fins qu'elle se propose : ce régime du police est fondé sur l'idée que la fin suffit à justifier les moyens. Exemples[modifier | modifier le code] [/!
Adolf Hitler Adolf Hitler[n 1], né le 20 avril 1889 à Braunau am Inn (Autriche-Hongrie) et mort suicidé le 30 avril 1945 à Berlin, est un idéologue d'extrême droite[4],[5] et un homme d'État allemand d'origine autrichienne. Fondateur et figure centrale du nazisme, il arrive au pouvoir en Allemagne en 1933 et instaure une dictature totalitaire, impérialiste, antisémite, raciste, homophobe, xénophobe, eugéniste et génocidaire désignée sous le nom de Troisième Reich. Dans un climat de violence politique, il occupe une place croissante dans la vie publique allemande avec le parti nazi. Alors que la Grande Dépression fait rage, il se présente à l'élection présidentielle de 1932 contre le président du Reich Paul von Hindenburg, qui est réélu. Cependant, après les élections législatives de novembre 1932, celui-ci nomme Hitler chancelier en janvier 1933. Origine du nom Hitler fut baptisé Adolphus Hitler[9]. Jeunes années Origines et enfance Adolf fait son entrée à l'école du village le 2 mai 1895. Le marginal
La Belgique épinglée pour ses propos racistes sur internet | Belgique La Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe a exprimé sa préoccupation à l’égard des discours de haine qui fleurissent sur internet en Belgique. Des pages web et forums de discussions racistes « La situation concernant le discours de haine sur internet est extrêmement préoccupante avec une forte augmentation des pages web et forums de discussion racistes sur les sites belges », note la Commission dans son 5e rapport sur la Belgique. Elle recommande à la Belgique d’intensifier ses efforts pour combattre l’expression du racisme sur internet et de coopérer au niveau international avec les autres États pour combler tout vide juridique permettant la diffusion de tels messages. Discrimination envers les musulmans Le rapport épingle aussi certains aspects des programmes d’intégration mis en en oeuvre dans les entités fédérées qu’elle juge « discutables, voire discriminatoires ». Discrimination fondée sur la langue Le rapport n’omet pas la question linguistique.
Autoritarisme Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le terme autoritarisme peut désigner aussi bien un comportement que le mode de fonctionnement d'une structure politique. L'autoritarisme consiste dans les deux cas en une prééminence, une hypertrophie de l'autorité érigée en valeur suprême. Si certains chercheurs et professeurs en science politique définissent l'autoritarisme comme un des trois grands types de systèmes politiques avec la démocratie et le totalitarisme, beaucoup d'autres considèrent cette classification comme trop formelle et ne correspondant pas à la réalité[1]. Un régime politique autoritaire est un régime politique qui par divers moyens (propagande, encadrement de la population, répression) cherche la soumission et l'obéissance de la société. Personnalité autoritaire[modifier | modifier le code] Une personnalité autoritaire se caractérise par une dérive de l'autorité vers une tentative de domination d'autres personnes. Concept politique[modifier | modifier le code] Ainsi :