


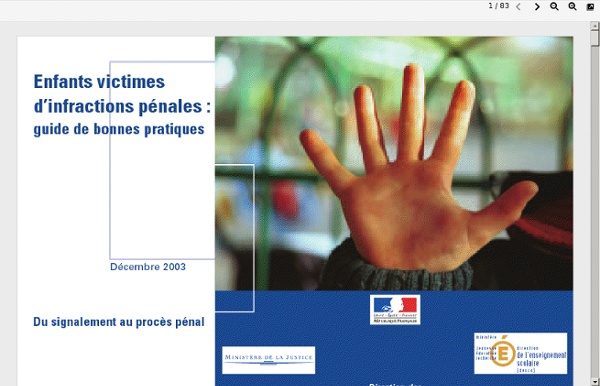
Ombres et lumières sur la protection de l'enfance Ombres et lumières sur la protection de l’enfance Les associations la Voix de l’enfant, Innocence en danger et Enfance et partage, parties civiles au procès des parents de la petite Marina, ont déposé plainte, l’une contre X pour non-assistance à personne en danger, les autres contre l’Etat pour faute lourde. Si ces plaintes sont instruites, gageons qu’elles apportent une autre lumière que celle, passionnelle et confuse, portée sur le dispositif de protection de l’enfance aux assises de la Sarthe. Les éclairages de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) et de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sont bienvenus pour mesurer les conséquences de la loi du 5 mars 2007 sur le transfert de compétence du parquet au conseil général et sur les moyens mis en œuvre pour ce faire, ainsi que l’évolution quantitative et qualitative de l’aide sociale à l’enfance depuis cette réforme. - 11 au moins un inspecteur enfance ou cadre ASE ;
Aide Sociale à l'Enfance Le Conseil Général est chargé de mettre en œuvre l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Il est ainsi le chef de file de la protection de l’enfance dans le département. L’ASE s’adresse aux mineurs, à leurs familles ainsi qu’aux mineurs émancipés. Cette aide concerne également les jeunes majeurs de moins de 21 ans en difficulté. Elle consiste à proposer un soutien matériel, éducatif et psychologique, en cas de « difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ». Prévention : l'Aide Sociale à l’Enfance L'ASE dispose d'un ensemble d'aides éducatives et financières destinées aux familles en difficulté. En marge de ses missions traditionnelles, le Conseil Général développe une politique volontariste de prévention et de soutien à la parentalité, pour faire face aux difficultés familiales. Accueillir pour protéger Pour accueillir temporairement les enfants et aider les familles en grande difficulté, deux types d’accueil sont possibles :
La santé des élèves Année scolaire 2016/2017 La politique éducative sociale et de santé contribue à la réussite scolaire, à la réduction des inégalités sociales et territoriales et participe à la politique de santé publique. L’effort budgétaire se poursuit depuis la rentrée 2016 avec la création d’emplois d’assistantes sociales et de personnels de santé. Ces nouveaux moyens permettront de renforcer la prévention dans le premier degré notamment en éducation prioritaire. La mise en œuvre du parcours éducatif de santé depuis la rentrée 2016 va préparer les élèves à devenir des citoyens responsables en matière de santé individuelle et collective. Télécharger l'intégralité de la fiche "La santé des élèves" Orientations pour une politique éducative de santé La politique éducative de santé constitue un facteur essentiel de bien-être des élèves, de réussite scolaire et d'équité. Sept objectifs prioritaires : Le parcours éducatif de santé Il prépare les élèves à prendre soin d’eux-mêmes et des autres. Hygiène de vie
Les chiffres clés en protection de l'enfance | Observatoire National de L'Enfance en Danger | Oned L’estimation du nombre d’enfants et de jeunes majeurs pris en charge en protection de l’enfance La situation des pupilles de l'Etat L'enquête IP réalisée en 2011 Les données statistiques annuelles du 119 Les sources de données L’estimation du nombre d’enfants et de jeunes majeurs pris en charge en protection de l’enfance L’ONED réalise une estimation du nombre de mineurs et jeunes majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection de l‘enfance au 31 décembre, en parallèle de la mise en œuvre du décret n° 2011-222 du 28 février 2011 (lien vers le dossier décret organisant la transmission d’informations sous forme anonyme aux Observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à l’ONED. Evolutions des prises en charge des mineurs en protection de l'enfance au 31 décembre (de 2003 à 2010) Champ : 0-17 ans faisant l'objet d'au moins une mesure. Evolutions des prises en charge des jeunes majeurs en protection de l'enfance au 31 décembre (de 2003 à 2010) La situation des pupilles de l’Etat
Les adolescents d’aujourd’hui sont-ils si différents des jeunes d’hier ? / Colette Barbier in Éducation santé, N°288 (2013/04) Le 8 novembre dernier, le Centre local de promotion de la santé de Bruxelles (CLPS) organisait une journée de réflexion sur le thème des assuétudes chez les adolescents. Intitulée «Et si nous prenions le risque d’être sur le fil?», cette journée fait suite aux résultats de l’enquête «Assu-Études» menée par le CLPS auprès des acteurs de 130 établissements secondaires bruxellois. Elle s’inscrit dans le cadre de la mission Point d’appui aux écoles secondaires en matière de prévention des assuétudes (1).Ce sont plus de 150 acteurs qui se sont réunis à la Maison des Associations Internationales pour réfléchir autour de quelques questions en guise de fil rouge: comment être à l’écoute des paradoxes des adolescents, des adultes, de l’école, de la prévention? Comment créer des espaces où peuvent s’inscrire la rencontre et la relation avec les adolescents et les adultes, entre l’école et la prévention?
Protection de l'enfance - Mission de l'École La mission de l'École se décline aux différents niveaux du système éducatif. Au niveau national La direction générale de l’Enseignement scolaire (DGESCO) élabore la politique éducative dans laquelle s'inscrit la prévention des risques et la protection des élèves. Elle participe à des instances interministérielles et institutionnelles notamment : Elle a participé jusqu'en décembre 2010 au groupe d'appui à la réforme de protection de l'enfance mis en place en 2007, piloté par la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE). Elle contribue à la connaissance des données chiffrées relatives à l’enfance en danger. Au niveau académique Les recteurs impulsent les orientations nationales et définissent les plans académiques de formation. Ils collectent annuellement les statistiques des services départementaux relatives aux transmissions d'informations préoccupantes aux conseils généraux et aux signalements judiciaires. Au niveau départemental
ADOLESCENCE: La génération de tous les excès ADOLESCENCE: La génération de tous les excès Actualité publiée le 15-11-2013 Insee La transition vers l’âge adulte est la période des expériences, que ce soit en matière de mode de vie ou de comportements à risque, jusque-là rien de nouveau. Mais cet arrêt sur image sur l’adolescence d’aujourd’hui et ses expérimentations, proposé, par l’Insee, dans sa collection « Portrait social », révèle de fortes tendances qui incitent à la vigilance. · Le binge drinking ou l’art de s’hyperalcooliser sur un très court laps de temps est typique d’une génération dont la moitié a été ivre au moins une fois au cours de l’année. · Si l’expérimentation de la cigarette arrive plus tard, fumer quotidiennement est le cas désormais de près d’un jeune de 17 ans avec une tendance certaine, depuis 2008, d’un rebond de la prévalence de l’usage quotidien atteignant 31,5 % en 2011 vs 28% en 2008, pour les filles comme les garçons. · Suralimentation, malbouffe, boulimie ? Réagissez à cette actu sur Santé Blog
Prévention de la violence en milieu scolaire - Mesure de la violence en milieu scolaire Conçu par la direction de l'Évaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP), en concertation avec les chefs d'établissement, le Système d'information et de vigilance sur la sécurité scolaire (SIVIS) repose sur un échantillon, scientifiquement élaboré, d'établissements publics du second degré, représentatif au niveau national (France métropolitaine et DOM). SIVIS a remplacé Signa (Signalement des actes de violence) à la rentrée scolaire 2007. Il est centré sur les actes de violence les plus graves : faits portés à la connaissance de la police, de la gendarmerie ou de la justice, faits susceptibles de donner lieu à dépôt de plainte ou à conseil de discipline et faits ayant entraîné des soins. Il comporte un questionnaire visant à mieux appréhender le climat dans l'établissement et son évolution, à travers six questions portant, par exemple, sur les relations entre les élèves, entre élèves et adultes, et l'ambiance générale ou encore la sécurité aux abords de l'établissement.
Détail d'une actualité - Un enfant exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité 30.10.2013 17:00 Il y a : 160 days Auteur : DK La violence conjugale constitue sans aucun doute la forme la plus courante de violence subie au sein de la famille et le climat qui en résulte affecte particulièrement les enfants. Même si la violence conjugale n’est pas directement dirigée contre les enfants, il s’agit d’une forme de maltraitance à leur égard et ils en sont victimes. Afin de renseigner les professionnels amenés à rencontrer ce type de situation, la publication « Un enfant exposé aux violences conjugales est un enfant maltraité » a été réalisée en collaboration avec différents secteurs, avec des acteurs de terrain : aide à la jeunesse, promotion de la santé, petite enfance, enseignement, ... Cette publication tente de répondre aux nombreuses questions que les professionnels en contact avec des enfants susceptibles d’être exposés aux violences conjugales pourraient se poser : Existe-il des signaux d’alerte spécifiques à la violence conjugale ?
Ouvrages recensés | Érudit | Revue des sciences de l’éducation v38 n2 2012, p. 425-427 | Résumé | Extrait L’objet principal de cet ouvrage est d’actualité, car le concept d’inclusion scolaire est complexe et présente souvent des aspects différents. Les auteurs y illustrent les diverses significations accordées au concept d’inclusion en s’appuyant sur une analyse empirique. Ils exposent les pratiques, les approches et les croyances des différents acteurs engagés de quatre provinces canadiennes, l’Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et le Québec, ainsi que de trois pays, l’Angleterre, la France et l’Italie. Au premier chapitre, Bélanger sonde un établissement en milieu urbain en Ontario afin de découvrir ce qu’est, selon des praticiens, des parents et des élèves, une école inclusive. Dans le deuxième chapitre est décrite une culture d’inclusion dans une école de langue française en situation minoritaire de la région de Toronto. Le troisième chapitre aborde le cas d’une école privée catholique dans le 20e arrondissement de Paris.
« Génération Quoi », la suite : les réponses des sociologues et des politiques Pondu par Marie.Charlotte le 25 février 2014 Les réponses du questionnaire « Génération Quoi » ont été analysées par des sociologues, et soumises à un panel de personnalités politiques. La jeunesse a parlé. Qu’en pensent les sociologues et les politiques ? Plus de 400 000 internautes, dont 215 000 jeunes ont répondu au questionnaire « Génération Quoi » que nous avions relayé en septembre 2013. Cette enquête accompagnait la réalisation et la diffusion de trois documentaires-reportages sur notre génération, une génération à définir, à travers trois « étapes », avec leurs rites de passages (ou leur absence) : Bac ou crève : l’entrée dans la vie active pour les jeunes sans diplômeMaster chômage et master classe : la sélection des filières « de la réussite » versus… toutes les autres.La vie, ça commence quand ? 14 thèmes et 24 vidéos, à découvrir L’équipe de Génération Quoi est également allée interpeller des responsables de politiques, de tous les partis, y compris les extrêmes. —— Indignés ——
Demain, tous des mutants ? Pourquoi la puberté se déclenche de plus en plus jeune | Atlantico.fr De la Chine aux États-Unis, des garçons pubères plus tôt « Où sont les sopranos ? », titrait en novembre 2013 le site Internet Atlantico qui se faisait l’écho d’un article du New York Times Magazine. Avec en soustitre : « La chorale de l’église Saint-Thomas de Leipzig, dont Jean-Sébastien Bach fut le directeur entre 1723 et 1750, est en manque de sopranos. Les jeunes chanteurs seraient atteints de puberté précoce1. » Invité à réagir à cette information, le pédiatre Michel Colle se montrait sceptique : « Cet article m’a beaucoup étonné […]. Je déplore ce qui arrive à ces directeurs de chorale, mais j’ai du mal à le croire. » IPour la puberté masculine, les observations fiables s’avèrent de fait plus délicates à collecter que chez les filles car le début du phénomène est moins apparent (pas de développement des seins). Dans le cas des États-Unis, le décalage est de six mois à deux ans par rapport à ce qui était observé plusieurs décennies auparavant. Qu’est-ce qui déclenche la puberté ?