


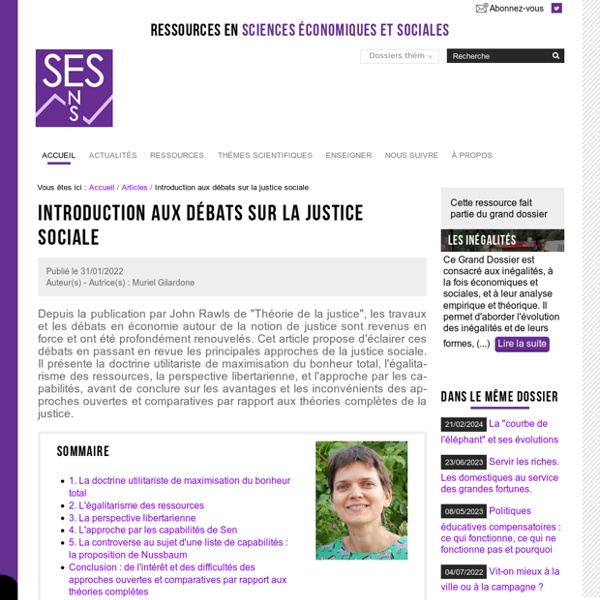
Un sentiment de discrimination en hausse depuis 10 ans, notamment chez les femmes. Insee. Juillet 2022. En dix ans, le sentiment de discrimination augmente, porté par les femmes et le motif sexiste, Insee Première n° 1911, 5 juillet 2022. Version imprimable. par Jérôme Lê, Odile Rouhban, Pierre Tanneau (Insee), Cris Beauchemin, Mathieu Ichou, Patrick Simon (Ined). Résumé En 2019-2020, 19 % des personnes de 18-49 ans déclarent avoir subi « des traitements inégalitaires ou des discriminations », contre 14 % en 2008-2009. Malgré une plus forte sensibilisation ces dix dernières années, entamer des démarches à la suite de discriminations reste rare. Sommaire Le sentiment de discrimination augmente de 5 points en dix ans.
Valeurs : les Français soutiennent massivement les plus pauvres – Centre d'observation de la société 50 % des Français estiment que les pouvoirs publics « ne font pas assez » pour les plus démunis, 41 % « ce qu’ils doivent » et 9 % trouvent qu’ils « font trop », selon le ministère des Solidarités (données 2021). La solidarité reste une valeur fortement ancrée dans la population française, comme le montrent deux enquêtes, l’une menée depuis 20 ans par le ministère des Solidarités (le baromètre d’opinion de la Drees), l’autre, depuis 40 ans par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) – enquête « conditions de vie et aspirations ». À la question du ministère des Solidarités « quelles sont les raisons qui, selon vous, peuvent expliquer que des personnes se trouvent en situation de pauvreté ? », la réponse (plusieurs sont possibles) qui arrive en tête est « parce qu’ils manquent de qualifications » pour 70 % des personnes interrogées en 2020. Des Français solidaires
Les maladies chroniques touchent plus souvent les personnes modestes et réduisent davantage leur espérance de vie. DREES, octobre 2022. Études et Résultats n° 1243, 06 octobre 2022. Version imprimable. Résumé Entre 2016 et 2017, les 10 % les plus modestes de la population française développent plus souvent une maladie chronique que les 10 % les plus aisés, à âge et sexe comparables (2,8 fois plus de diabète, 2,2 fois plus de maladies du foie ou du pancréas, 2,0 fois plus de maladies psychiatriques, 1,6 fois plus de maladies respiratoires chroniques, 1,5 fois plus de maladies neurologiques ou dégénératives et 1,4 fois plus de maladies cardioneurovasculaires). En revanche, ils développent relativement moins de cancers. Le risque de déclarer une maladie chronique est aussi très variable entre les groupes socioprofessionnels. Comme elles développent plus souvent des maladies chroniques, les personnes les plus modestes sont aussi plus nombreuses à vivre avec l'une de ces maladies, et ce, bien que leur mortalité soit relativement plus élevée lorsqu'elles sont malades. Sommaire Cliquez sur les images pour agrandir les figures.
Les plus pauvres sont plus concernés par les maladies graves de longue durée En France, à âge et sexe identiques, les plus modestes sont plus exposés aux maladies chroniques, c’est-à-dire graves et longues (voir encadré), que les plus aisés selon le ministère de la Santé [1]. Les 10 % aux revenus les plus bas ont ainsi 2,8 fois plus de risques de développer un diabète que les 10 % les plus riches. Ce risque est 2,2 fois plus élevé en ce qui concerne les maladies du foie ou du pancréas et les maladies psychiatriques. De la même manière, les plus pauvres sont 1,6 fois plus exposés aux maladies respiratoires chroniques et 1,5 fois plus aux maladies neurologiques ou dégénératives comme, par exemple, la maladie de Parkinson et la maladie d’Alzheimer. Les maladies cardiovasculaires, qui sont les maladies chroniques les plus fréquentes en France, concernent 1,4 fois plus les populations pauvres. La survenue de maladies chroniques est plus importante chez les moins qualifiés. Ces données démontrent l’ampleur des inégalités sociales de santé. Photo / © Light Design
Conférence APSES-Lyon « Politiques éducatives compensatoires : ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ? » L’association Les Amis de Veblen et l’APSES Lyon organisent une conférence en visio ce jeudi 12 janvier 2023, accessible à toutes et tous. Rendez-vous le jeudi 12 janvier, en visioconférence à 20 h, pour entendre Manon Garrouste, maître de conférence en économie à l’Université de Lille, chercheuse au LEM-CNRS, spécialiste de l’évaluation des politiques publiques et des politiques de la ville qui viendra nous parler de ses travaux sur les effets du classement en zones prioritaires des collèges et sur les difficultés rencontrées dans la lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire. Titre de son exposé : Politiques éducatives compensatoires : ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ? Résumé : En France les politiques d’éducation prioritaire ciblent des établissements scolaires sur la base de désavantages académiques et sociaux.
Les inégalités d'accès aux crèches et leurs enjeux économiques. DG du Trésor. 2023. Trésor-éco n° 322, 26 janvier 2023. Version téléchargeable. par K. Ishii, P. Y. Résumé Les politiques publiques d'accueil des enfants de moins de 3 ans poursuivent un double objectif : soutenir l'activité professionnelle des parents et favoriser le développement des enfants jusqu'à leur entrée à l'école maternelle. Lors des premiers mois de l'enfant, c'est la garde par les parents qui est la plus favorable à son développement, surtout lorsqu'elle est exercée par les deux parents. En France, l'indemnisation du congé parental pris à la suite des congés maternité et paternité reste relativement faible par rapport à d'autres pays. Cependant, le niveau de recours varie fortement avec le revenu disponible du foyer. On constate en outre que les familles monoparentales, bien qu'elles fassent l'objet d'un soutien financier spécifique, ont un taux de recours à un mode de garde formel très inférieur à celui des couples biactifs. Sommaire Cliquez sur les images pour agrandir les figures.
Une enquête dévoile les ressentis des personnes victimes de racisme La ministre déléguée auprès de la première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, Isabelle Rome déclarait le 30 janvier dernier lors de la présentation du Plan national de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations liées à l’origine 2023-2026 : « Les racistes, les antisémites, les antitsiganes, ceux qui distinguent les êtres selon ou en raison d’une couleur de peau, d’une religion, ou d’une nationalité, sont nos ennemis les plus redoutables. Ils sont les ennemis de la République. » Ce discours s’inscrit en effet dans un climat national tendu en France concernant ces discriminations. Sur la base d’enquêtes qualitatives et quantitatives dans différentes villes de France, il nous a été possible de cumuler des données à partir d’un questionnaire diffusé entre 2015 et 2020, et portant sur le vécu des discriminations dans la ville. Que ressentent les individus ? Différentes perceptions des discriminations
Les policiers noirs ont les mêmes préjugés anti-Noirs que la police et la société américaines Violemment interpellé à Memphis le 7 janvier pour conduite dangereuse par cinq policiers noirs de l’unité « SCORPION », depuis dissoute, Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, est mort trois jours plus tard des suites de ses blessures. Aux États-Unis, la police tue près de mille personnes par an. Les Noirs sont sur-représentés parmi les tués, et spécialement parmi les victimes d’interpellations à la brutalité injustifiée. Read more: Mort de George Floyd : des images traumatisantes de sinistre mémoire Dans chacune de ces affaires, la question des préjugés des policiers impliqués (majoritairement blancs) à l’égard des citoyens noirs a été mise en avant, suscitant le grand mouvement de protestation ayant pris pour slogan « Black Lives Matter ». Comment expliquer l’acharnement des policiers dans l’affaire Nichols ? Aux États-Unis, les structures chargées du maintien de l’ordre ont de tout temps considéré les Noirs américains comme des ennemis intérieurs.
The Other Economy - Comment mesurer la pauvreté ? La pauvreté n'est pas qu'une histoire d'argent Mesure de la pauvreté relative au sein d'un pays : les cas européen et états-unien La comparaison des taux du risque de pauvreté au sein de l’UE révèle de fortes disparités entre les pays. En 2021, la Lettonie a le taux de pauvreté monétaire le plus élevé (23,9 %.) D’autres pays, à l’image de la Roumanie et la Bulgarie, se démarquent également par des taux du risque de pauvreté supérieurs à 20 % –plus d’une personne sur cinq est donc en situation de risque de pauvreté dans ces pays. La France occupe une position intermédiaire, avec un taux du risque de pauvreté de 14,4 %, tandis que la République tchèque présente le taux le plus bas au sein de l’UE (8,6 %). Taux du risque de pauvreté (pauvreté monétaire) dans les pays de l’Union européenne, 2021 (en %). Lecture : en France, en 2021, le taux du risque de pauvreté est de 14,4 %. Le choix d’un tel indicateur pour caractériser la pauvreté monétaire présente deux conséquences majeures. Source U.S.
“L’effet Matthieu”, ou comment le système social profite davantage aux riches qu’aux pauvres L’idée reçue que décrit Le Vif-L’Express est loin d’être une spécificité belge : elle consiste “à considérer les plus précaires comme des profiteurs, et les plus laborieux, tous rangés dans une gigantesque ‘classe moyenne’ qui se ferait ‘matraquer’, comme les ‘pigeons du système’”. En réalité, c’est l’inverse qui se produit, explique le magazine belge, en s’appuyant sur le principe théorisé par le sociologue américain Robert King Merton, puis par l’économiste flamand Herman Deleeck en 1978 : l’effet Matthieu. Lequel tire son nom de l’apôtre Matthieu et du verset 13, chapitre 12 de la Bible. “Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a.” Appliqué à la société moderne, ce principe traduit le fait qu’en vertu d’une “série de mécanismes” les politiques sociales profitent davantage aux riches qu’aux pauvres qui, proportionnellement, y contribuent davantage, résume Le Vif. Les inégalités se creusent
L’Index de l’égalité professionnelle : utile mais imparfait. Céreq. Octobre 2022. — Sciences économiques et sociales Céreq Bref, n°428, 13 octobre 2022. Version imprimable. Résumé Mis en place à partir de 2019, l’Index de l’égalité professionnelle oblige désormais toutes les entreprises de plus de 50 salariés à calculer et publier leur note en matière d’écarts de rémunérations entre hommes et femmes. Sommaire Un outil de mesure de l’écart salarial « résiduel » Premiers résultats et perception de l’Index dans les entreprises Les écarts de rémunération entre hommes et femmes Les écarts d’augmentations individuelles et de promotion Nombre de salariées augmentées au retour d’un congé de maternité Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations Une utilisation différenciée de l’Index selon les types d’entreprises Cliquez sur l'image pour agrandir la figure. Source : Céreq Bref, n° 428, octobre 2022. Pour aller plus loin : Breda T., Dutronc-Postel P., Sultan K., Tö M. (2020), « Inégalités femmes-hommes au sein des entreprises : que mesure l’Index de l’égalité professionnelle ?
L’accès à l’emploi des immigrés et enfants d’immigrés La majorité des immigrés sortis du système éducatif en 2017 sont originaires d’Afrique. Ils représentent 4 % des sortants de 2017, soit davantage qu’en 2004 (2 %). Cette « première génération » immigrée et la deuxième ne partagent pas, en moyenne, le même capital socioculturel. Ils n’accèdent pas non plus à l’emploi dans les mêmes conditions.
Les plus modestes vivent deux à trois plus souvent dans des logements bruyants, humides ou difficiles à chauffer Pas moins de 11 % des Français, soit 7,5 millions de personnes, trouvent [1] que leur logement est humide, selon les données 2019 de l’Insee. 18 %, soit 12 millions, estiment qu’il est bruyant. Enfin, 23 % déclarent qu’il est difficile à chauffer, soit plus de 15 millions de personnes. Certes, le confort des logements tend à s’améliorer en France sur longue période. Si trop de ménages vivent encore dans l’insalubrité, la part des logements sans salle de bain ou toilettes a beaucoup diminué, de 39 % en 1973 à moins de 1 % aujourd’hui. Pour autant, la mauvaise qualité de l’habitat persiste, avec des logements situés aux abords de sources de bruits importants (routes, voies de chemin de fer, aéroports, etc.), mal insonorisés, mal ventilés et dotés d’un système de chauffage ancien, parfois très coûteux. Ces améliorations masquent aussi des écarts énormes selon le niveau de vie. Photo / © Evgen Prozhyrko [1] Ces données sont déclaratives.