


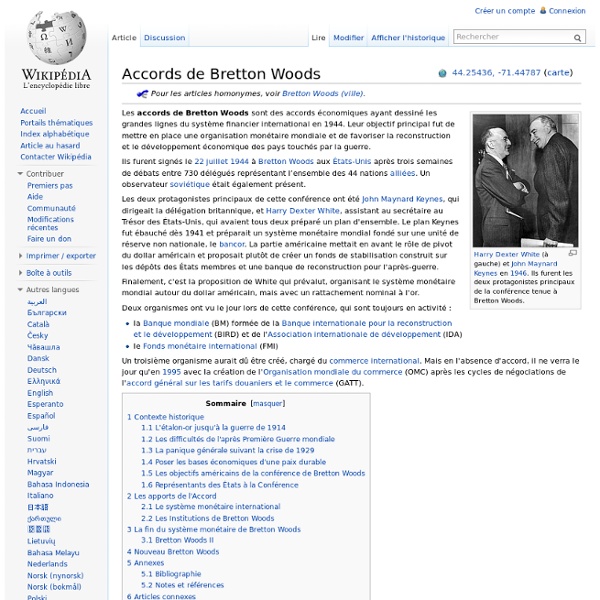
La révoltante histoire de la "Réserve fédérale" américaine, hold-up planétaire sur la création monétaire Chers amis, Je suis en train de dévorer deux livres importants — enfin traduits en français — que je vous conseille de découvrir urgemment. Il s'agit de l'histoire étonnante —et éclairante— de la prétendue "Réserve fédérale américaine" (qui n'est ni réserve, ni fédérale, ni même américaine peut-être...), histoire minutieusement et patiemment reconstituée par deux chercheurs Américains, qui ont consacré toute leur vie à reconstituer ce puzzle compliqué. Histoire éclairante parce que, manifestement, toutes les banques centrales du monde —y compris la BCE— se sont inspirées de ce modèle maffieux qui vole la création monétaire aux puissances publiques, finance toutes les guerres et les arsenaux, et assujettit les peuples par la dette. Je ne sais pas s'il est encore possible de venir à bout de ce monstre, mais si tout cela est vrai, il est urgent de lui résister. • "Les secrets de la Réserve Fédérale. Avant-propos du traducteur (du livre de Mullins) : Jean-François Goulon Août 2010 Introduction
13 décembre 2007 Traité de Lisbonne Le traité de Lisbonne Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le 1er décembre 2009[2], soit le premier jour du mois qui suit l'achèvement du processus de ratification dans les vingt-sept États signataires de l'époque, avec dépôt des instruments de ratification à Rome. Généralités[modifier | modifier le code] Le texte du traité a été approuvé par le Conseil européen de Lisbonne, le 19 octobre 2007, et signé le 13 décembre de la même année[3] par les 27 chefs d'État ou de gouvernement, également à Lisbonne, pour être ensuite ratifié par chaque État membre selon ses propres procédures de ratification. Le mandat donné à la « CIG 2007 » résulte du « projet de mandat pour la CIG », un document de quinze pages[4], annexé aux conclusions du Conseil européen de Bruxelles du 23 juin 2007. « Traité modificatif » plutôt que « traité simplifié » ou « mini-traité »[modifier | modifier le code] De plus, sa complexité rédactionnelle est très élevée. Calendrier[modifier | modifier le code]
10 choses que vous devez savoir sur le Pacte budgétaire Ce Pacte budgétaire a été conçu dans l’urgence, et sous de très mauvais auspices : ses promoteurs avaient initialement prévu de l’adopter sous forme de modification des traités existants, mais le véto de la Grande-Bretagne, lors du Conseil européen du 9 décembre, les a obligé à créer un nouveau Traité ad hoc. Cette procédure permettait en outre une adoption plus « souple » et « simple », c’est-à-dire qu’elle garantissait moins d’« interférences » liées à tout débat public et démocratique, en adoptant un traité de l’Union européenne qui n’en était pas vraiment un. Ce Pacte budgétaire a pour vocation à obliger les États signataires à appliquer des politiques budgétaires très strictes via un renforcement des règles et contrôles. Entre autres, les dénommés « déficits structurels » devront rester sous la limite de 0,5% du PIB. Pourquoi maintenant ? Trois nouveautés Dénouer l’enchevêtrement de ces mesures peut s’avérer compliqué. 1. Qu’est-ce que le déficit structurel ? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Procès accusant le Vatican d’avoir financé ses réseaux d’exfiltration par l’or des nazis Le temps passe pour les victimes de l’Holocauste Croate et lorsque les derniers témoins auront disparus il sera plus facile pour le Vatican de prétendre qu’il ne s’est rien passé. L’enjeu est énorme, le Vatican ne voulant pas voir de plaintes similaires concernant des l’or des victimes’ allemandes, bien plus nombreuses. Par Muriel Fraser de la National Secular Society Traduction par Stephane Mabille de la National Secular Society Le contexte: Ci-contre l’armoirie de "l’Etat indépendant de Croatie” mis en place par Hitler et Mussolini en 1941. Hitler et Mussolini installèrent Ante (Anthony) Pavelic à la tête du gouvernement. le nouvel état de Pavelic étant composé principalement de deux groupes : les Serbes et les Croates, deux ethnies Slaves partageant la même langue, le Serbo-Croate. Les Serbes, Juifs et Roms furent exterminés dans leurs villages après avoir été torturés, ou brulés vivant dans leur Eglises. Notes
Uriage, l'école des cadres de la Collaboration En abrogeant la République et en proclamant l’État français [1], Philippe Pétain n’ouvre pas « une parenthèse dans l’histoire » [2], mais place au pouvoir des factions actives de la droite française avides de prendre leur revanche aussi bien sur la gauche du Front populaire que sur 1789. Les anciens combattants de la Première Guerre mondiale, les traditionalistes, les insurgés du 6 février 1934 et les « techniciens » [3], en rupture avec le parlementarisme, se disputent les postes politiques. Mais l’État français n’est pas seulement le théâtre d’une confiscation du pouvoir, il est aussi porteur d’un projet idéologique, la Révolution nationale. Le blason de l’école d’Uriage Le « maréchal » Pétain [4] confie aux traditionalistes l’Éducation nationale et les mouvements de la Jeunesse : les Chantiers de la jeunesse sont placés sous la responsabilité du général La Porte du Theil, tandis que Georges Lamirand devient secrétaire à la Jeunesse. Histoire de l’école des cadres d’Uriage
Portail:Relations internationales Un domaine d'excellence des universités britanniques puis américaines Régulièrement, un ouvrage de politiste américain, capture l'air du temps provoque le débat autour d'une nouvelle « grille de lecture » ou théorie unificatrice de la politique internationale. Les plus marquants parmi l'école réaliste assez conservatrice ces dernières années sont : On peut également relever l'article « Les sources de la conduite soviétique » (1947) écrit sous le pseudonyme de « X » par George F. Kennan, qui préconisait la stratégie à adopter par les États-Unis pendant la guerre froide. La guerre d'Espagne vue à travers les affiches Contexte historique L’intervention étrangère dans la guerre d’Espagne L’échec du soulèvement militaire contre le gouvernement du Front populaire qui avait remporté les élections en Espagne en février 1936 ouvrit la voie à une guerre civile de longue durée, qui prit rapidement des proportions inattendues et entraîna l’intervention de grandes puissances étrangères. Tandis que l’Italie de Mussolini apporta son soutien militaire et financier dès le début aux nationalistes, bientôt rejointe par l’Allemagne de Hitler, la France et l’Angleterre, fidèles à l’esprit pacifiste qui animait leur politique étrangère, préférèrent adopter une position neutre, même si, dans les premiers temps du conflit, le gouvernement français avait envoyé des avions aux républicains espagnols : elles se bornèrent à mettre sur pied un Comité international de non-intervention. Analyse des images L’affiche, moyen de propagande Interprétation La dimension internationale de la guerre civile espagnole
Sutton - Wall Street and the Bolshevik Revolution Régimes multilatéraux de contrôle des exportations Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les régimes multilatéraux de contrôle des exportations (ou RMCE) sont nés de la volonté des principaux États producteurs et exportateurs d'armements et de technologies à double usage, d'une part, d'harmoniser leurs politiques d'exportations de ces biens et, d'autre part, de compenser les lacunes des traités internationaux en la matière. L'objectif ultime de ces RMCE est donc d'empêcher la prolifération incontrôlée de ces biens. En pratique, les RMCE sont des réunions informelles et volontaires d'États qui définissent une politique commune de contrôle des exportations de biens et technologies nucléaires afin de prévenir et d'empêcher leur prolifération incontrôlée. À l'heure actuelle, il existe cinq RMCE ayant pour objectif la régulation de la prolifération : Adhésion[modifier | modifier le code] Voir aussi[modifier | modifier le code] Lien externe[modifier | modifier le code]
Le Sionisme et le Troisième Reich Au début de 1935, un bateau rempli de passagers, à destination de Haïfa en Palestine, quitta le port allemand de Bremerhaven. Sa poupe portait son nom en lettres hébraïques : «Tel-Aviv», alors qu'un drapeau à croix gammée flottait en haut du mât. Et bien que le bateau était une propriété sioniste, son capitaine était un membre du Parti National-socialiste. De nombreuses années plus tard, un ancien passager du bateau appela cette association de symboles «une absurdité métaphysique». Absurde ou pas, il s'agit d'une facette d'un chapitre peu connu de l'histoire : la collaboration de grande ampleur entre le Sionisme et le Troisième Reich hitlérien. Objectifs communs Pendant des années, des gens de nombreux pays se sont interrogés sur la «question juive» : c'est-à-dire, quel était le rôle exact des Juifs dans les sociétés non-juives ? Collaboration active La SS fut particulièrement enthousiaste dans son appui au Sionisme. Les dirigeants sionistes dans d'autres pays firent écho à ces vues.