


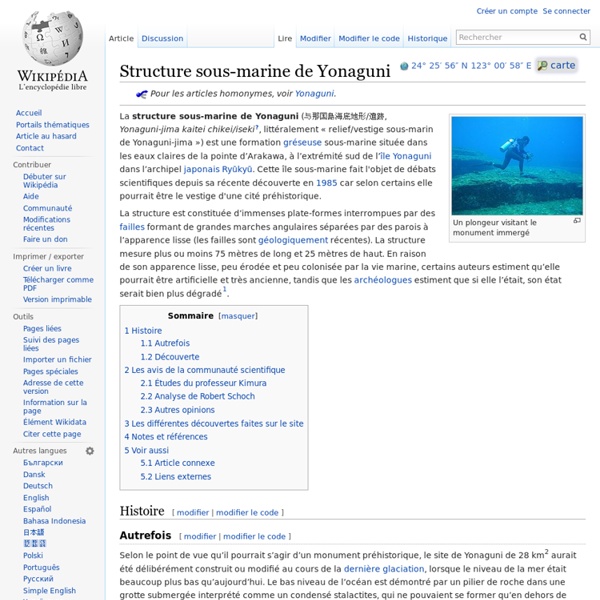
Héracléion Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Photos[modifier | modifier le code] Références[modifier | modifier le code] Liens externes[modifier | modifier le code] Sur les autres projets Wikimedia : Héracléion, sur Wikimedia Commons ruines dans le pacifique Sa datation a révélé que l'édifice remontait à au moins 8000 ans av. jc Le mur de l'Ancienne ville sous marine de Hujing La maison en pierre de Taga Des mégalithes faits de blocs basaltiques bleu-noir en forme de prismes hexagonaux et disposés en croix. 400 larges tumulis vieux de 3000 ans Le trilithon de Ha’amonga et les ruines d'un port Des temples en forme de pyramide et des routes Une route antique fait le tour de l'île Les Marae Mahaiatea Des collines découpées en terrasses Mohenjo-daro Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Mohenjo-daro — littéralement le Mont des morts, un nom qu'il partage avec Lothal — est un site important de la civilisation de la vallée de l'Indus, on y trouve les vestiges d'une des plus grandes cités de l'âge du bronze Indien. Il est situé au Pakistan à 300 km au nord-nord-est de Karâchi. Ayant subi peu de dégradations modernes, son état de conservation est meilleur que celui d'Harappâ, et par suite, c'est une importante source d'informations sur la civilisation à laquelle la ville appartenait. Découverte d'une civilisation inconnue[modifier | modifier le code] Les travaux effectués sur le site ont permis de dégager une centaine d'hectares des ruines de la ville, dix fois plus que ce qui avait été révélé dans les années 1920, mais probablement seulement un tiers de la surface totale à étudier. Les deux villes[modifier | modifier le code] On estime généralement la population de la ville à 40 000 personnes. Sur les autres projets Wikimedia :
The Ocean Explorer Harappa Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le site couvre les ruines d'une ville fortifiée de l'âge du bronze importante [1], faisant partie de la culture des cimetières H (en) de la civilisation de la vallée de l'Indus[2]. La cité aurait compté jusqu'à 40 000 habitants[3] et occupé une surface de 100 ha à son apogée (vers 2600–1900 avant J.C), ce qui en aurait fait une des plus grande de l'époque[4],[5]. Par convention archéologique qui consiste à donner à une civilisation inconnue le nom du premier site de fouilles, la civilisation de la vallée de l'Indus est aussi appelée civilisation harappéenne. Histoire[modifier | modifier le code] Civilisation de la vallée de l'Indus La civilisation de la vallée de l'Indus, connue également sous le nom de civilisation harappéenne, trouve probablement ses origines dans la culture de Mehrgarh, 6000 ans avant J.C. Histoire de la découverte[modifier | modifier le code] Alexander Cunningham y fait brièvement des fouilles en 1872-1873[8].
Patrimoine culturel subaquatique - International Council on Monuments and Sites ICICH - Comité international sur le patrimoine culturel immatériel Les objectifs de ICICH, liés à ceux de l’ICOMOS, sont : - Promouvoir la coopération internationale dans l'identification, l'étude et la solution de questions liées à l'identification éthique, la protection, l'interprétation et la gestion des associations culturelles immatérielles attribuées aux monuments et des sites. - Coopérer avec les Comités Scientifiques Internationaux de l’ICOMOS dans l'examen de documents doctrinaux aussi bien que dans la gestion et des pratiques de conservation, dans la lumière du rôle des attributs immatériels dans la signification et les valeurs de sites du patrimoine culturel. Pas de site Internet à l'heure actuelle.
Civilisation de la vallée de l'Indus Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Aire de la civilisation de la vallée de l'Indus. La civilisation de la vallée de l'Indus (v. 5000 av. J. Oubliée par l’Histoire jusqu’à sa redécouverte dans les années 1920, la civilisation de l’Indus se range parmi ses contemporaines, la Mésopotamie et l’Égypte ancienne, comme l’une des toutes premières civilisations, celles-ci étant définies par l’apparition de villes, de l’agriculture, de l’écriture, etc. Si la civilisation de l’Indus n’est pas la première civilisation antique, la Mésopotamie et l’Égypte ayant développé des villes peu avant, elle est cependant celle qui connaît la plus grande extension géographique. La plupart des autres sites se situent le long de la vallée de l’Indus et de ses affluents mais on en trouve aussi à l’ouest jusqu’à la frontière de l’Iran, à l’est jusqu’à Delhi, au sud jusque dans le Maharashtra et au nord jusqu’à l’Himalaya. Malgré toutes ces réalisations, cette civilisation est très mal connue. Pot incisé.
Top 8 des villes englouties, les ruines sous l’eau, c’est encore plus beau Éruptions volcaniques et plaques tectoniques obligent, il y a eu au cours des siècles passés pas mal de jolies petites bourgades inondées, voire carrément submergées. Aujourd'hui à plusieurs mètres de profondeur, ces sites sont encore visitables si vous avez une bonne paire de palmes et que vous n'êtes pas trop mauvais plongeur. Et croyez-nous, ça vaut le détour. Lion City (Chine) Située dans le lac artificiel de Qiandao, Lion City aurait abrité 290 000 habitants pendant plus de 1300 ans. Aujourd'hui à 26 mètres de profondeur, l'ancienne cité est extrêmement bien conservée et ses ruines découvertes en 2001 sont particulièrement impressionnantes. Pour votre gouverne, Lion City aurait été, entre les VIIe et les VIIIe siècles, un centre économique et culturel majeur pour la Chine. Et sinon, d'après les scientifiques, Venise et Miami devraient elles aussi bientôt couler.
Stonehenge Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L'ensemble du site de Stonehenge et le cromlech d'Avebury, à une quarantaine de kilomètres au nord, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco dans un ensemble intitulé « Stonehenge, Avebury et sites associés ». Aujourd'hui, le site attire près d'un million de visiteurs par an[2]. Histoire et description[modifier | modifier le code] Plan du site de Stonehenge.1. la pierre d'autel ; 2 et 3. tumuli ; 4. la pierre de sacrifice ; 5. la « Heel Stone » (pierre talon) ; 6. deux des quatre « stations » ; 7, 8, 9. fossés, talus ; 10. l'« avenue » monumentale, qui mène à la rivière Avon, à trois kilomètres à l'est ; 11 et 12. les deux cercles de 30 trous « Y » et « Z » ; 13. les 56 trous d'Aubrey ; 14. entrée secondaire. Chronologie, datation[modifier | modifier le code] La datation et la compréhension des différentes phases de l'activité de Stonehenge ne sont pas une tâche aisée. Stonehenge I (-2800/-2100). La Heel Stone
New Underwater Finds Raise Questions About Flood Myths Brian Handwerkfor National Geographic News May 28, 2002 Ancient stories of massive floods pass from generation to generation and in many places in the world are integral to a people's spoken history. The tales differ by locale, but commonly feature torrential rains or a hugely destructive wall of water bursting into a valley, destroying everything in its path. Many scientists, historians and archaeologists view these enduring tales as short, dramatised versions of the memory of rising seas at the end of the Ice Age. While images of catastrophic floods are popular, many scholars argue that the real rising sea level slowly invaded the Stone Age hunting territories for thousands of years, and the stories compress this event into overnight floods, storms, and destruction. Recent undersea findings may yield new clues to the study of human habitations that now lie beneath the waves. Cuba's Sunken City Further research is scheduled to take place over the summer.
La Cité Perdue