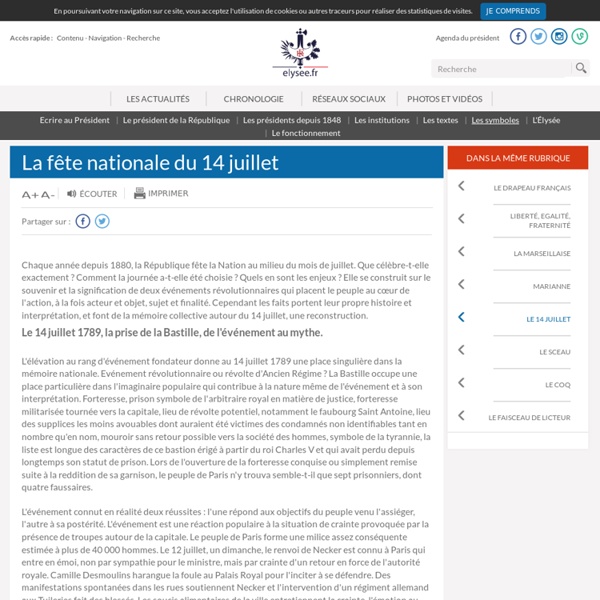Jacques Lévy, Ogier Maitre, Jean-Nicolas Fauchille et Ana Póvoas : Bonnes feuilles de l’Atlas politique de la France.
Des révolutions de moins en moins silencieuses. Jacques Lévy, Ogier Maitre, Jean-Nicolas Fauchille et Ana Póvoas Lévy, Jacques, Ogier Maitre, Jean-Nicolas Fauchille et Ana Póvoas (dirs.). 2017. Atlas politique de la France.
Liberté, Egalité, Fraternité
Héritage du siècle des Lumières, la devise " Liberté, Egalité, Fraternité " est invoquée pour la première fois lors de la Révolution française. Souvent remise en cause, elle finit par s'imposer sous la IIIème République. Elle est inscrite dans la constitution de 1958 et fait aujourd'hui partie de notre patrimoine national. Estampe du XVIIIème siècle, représentantla devise de la République française ©Rmn Associées par Fénelon à la fin du XVIIème siècle, les notions de liberté, d'égalité et de fraternité sont plus largement répandues au siècle des Lumières. Lors de la Révolution française, " Liberté, Egalité, Fraternité " fait partie des nombreuses devises invoquées.
Le drapeau français
Emblème national de la Cinquième République, le drapeau tricolore est né de la réunion, sous la Révolution française, des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). Aujourd'hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu'elles soient civiles ou militaires. "Juillet 1830" le drapeau tricolore,Collection de Vinck (1830) ©BnF Le drapeau tricolore n'a pas encore son historien. Son origine reste de ce fait encore largement méconnue, mais cela laisse la place à de multiples récits et anecdotes qui -- même s'ils ne sont pas toujours vérifiés -- rendent la naissance du drapeau national plus pittoresque voire poétique car nombre d'hommes illustres se sont, dit-on, penchés sur son berceau pour le parer de ses couleurs.
Le vieux monde de l’ONU
Recensé : Chloé Maurel, Une brève histoire de l’ONU au fil de ses dirigeants, Paris, Éditions du Croquant, 2017, 176 p., 15 €. « À quoi sert l’ONU ? » Cette question qui introduit le livre de Chloé Maurel ne cesse de susciter commentaires et analyses dont l’institution ressort vilipendée, excusée ou louangée. Après Histoire des idées des Nations Unies [1], étude exhaustive de la quête de démocratie, de progrès et de raison qui a été celle de l’ONU, comme en témoignent les concepts qu’elle a contribué à forger en matière d’économie, de discriminations, d’écologie (la grande absente de la Charte des Nations Unies) [2], Chloé Maurel déroule trois quarts de siècle au cours desquels des hommes — trop essentiellement des hommes —, dans un continuum de tensions, de crises, de fléaux et de guerres, ont agi ou essayé d’agir.
Marianne
Même si la Constitution de 1958 a privilégié le drapeau tricolore comme emblème national, Marianne incarne aussi la République Française. Le 28 juillet 1830: La Liberté guidant le peuplepar Eugène Delacroix © Rmn Les premières représentations d'une femme à bonnet phrygien, allégorie de la Liberté et de la République, apparaissent sous la Révolution française. Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome.
La Marseillaise
A l'origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté, la Marseillaise s'est imposée progressivement comme un hymne national. Elle accompagne aujourd'hui la plupart des manifestations officielles. Claude Joseph Rouget de Lisle chantant la marseillaisePaul Adolphe Rajon (XIXème siècle), BnF
Les missions et l'organisation du collège Waldeck-Rousseau - La p@sserelle -Histoire Géographie-
Objectifs Je comprends le fonctionnement du collège : qui fait quoi ?Je comprends les missions du collège : qu’est-ce que je fais là ?Je travaille en groupe et au CDI autour d’une tâche complexe I. Etre collégien à Waldeck-Rousseau
Liberté, poème de Paul Eluard
Juan Gris, La fenêtre ouverte, 1921 Sur mes cahiers d’écolier Sur mon pupitre et les arbres Sur le sable sur la neige J’écris ton nom Sur toutes les pages lues Sur toutes les pages blanches Pierre sang papier ou cendre J’écris ton nom
Liberté (Poésie et vérité) Paul Eluard
Statue de la liberté à New-York Cliquer pour agrandir Poème "Liberté, j'écris ton nom" (Poésies et Vérité 1942) La liberté a été longue à conquérir, en 2015, 11 personnes ont payé de leur vie le droit de critiquer.
La didactique de l’éducation à la citoyenneté en colloque (1) – présentation
Les enjeux de l’éducation à la citoyenneté ont été depuis deux ans renouvelés par des orientations politiques prises à l’échelle nationale (onze mesures pour une grande mobilisation de l’Ecole pour les valeurs de la République annoncées par la ministre N. Vallaud-Belkacem le 22 janvier 2015) et européenne (déclaration de Paris du 17 mars 2015 des ministres européens de l’éducation de l’Union européenne portant sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination). Au sein du système éducatif français, de nouvelles prescriptions curriculaires sont apparues : le domaine 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture entré en vigueur en septembre 2016 porte sur la formation de la personne et du citoyen, l’enseignement moral et civique a été mis en place du cours préparatoire au baccalauréat, un parcours citoyen a été créé. De ce point de vue, quelques éléments ressortent des trois jours de débats :
Tableau à agrandir : La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix
Achevé en décembre, le tableau est exposé au Salon de mai 1831. Il semble né d’un seul élan. Mais il découle des études faites pour les œuvres philhellénistes et d’une recherche nouvelle de détails et d’attitudes. C’est l’assaut final. La foule converge vers le spectateur, dans un nuage de poussière, brandissant des armes. Elle franchit les barricades et éclate dans le camp adverse.