


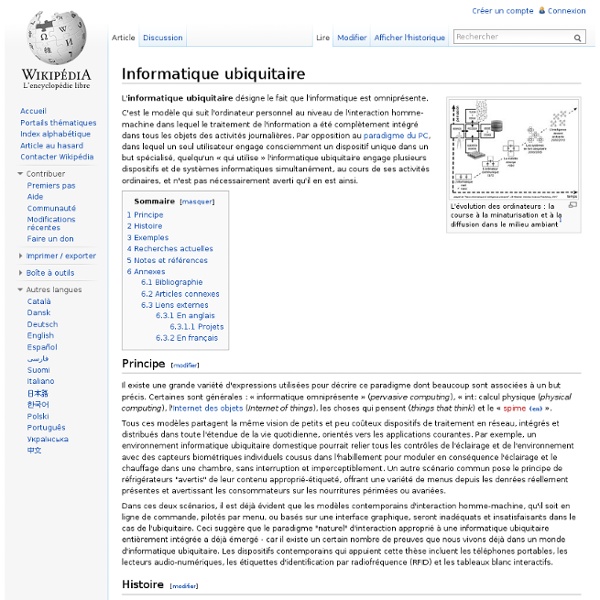
Spime Spime is a neologism for a currently theoretical object that can be tracked through space and time throughout its lifetime. The name "spime" for this concept was coined by author Bruce Sterling. Sterling sees spimes as coming through the convergence of six emerging technologies, related to both the manufacturing process for consumer goods, and through identification and location technologies.* "Spime" was probably first used in a large public forum by Sterling at SIGGRAPH Los Angeles, August 2004. The idea was further expanded upon in Shaping Things. These six facets of spimes are: With all six of these, one could track the entire existence of an object, from before it was made (its virtual representation), through its manufacture, its ownership history, its physical location, until its eventual obsolescence and breaking-down back into raw material to be used for new instantiations of objects. See also[edit] References[edit] External links[edit]
Intelligence ambiante Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L'évolution des ordinateurs : la course à la miniaturisation et à la diffusion dans le milieu ambiant L'intelligence ambiante est ce que pourrait devenir l'informatique dans la première moitié du XXIe siècle en repoussant les limites technologiques qu'elle avait à la fin du XXe siècle [réf. nécessaire]. Ce concept semble pouvoir tenir lieu de traduction non littérale aux concepts nés en Amérique du Nord sous le vocable initial d'informatique ubiquitaire, systèmes pervasifs ou encore ordinateur évanescent [réf. nécessaire]. Dans cette approche, le concept même de système d’information ou d'ordinateur change : d’une activité de traitement exclusivement centrée sur l’utilisateur, l'informatique devient interface entre objets communicants et personnes, et entre personnes [réf. nécessaire]. Facteurs en jeu[modifier | modifier le code] Vers une informatique diffuse[modifier | modifier le code] Perspectives économiques[modifier | modifier le code]
Mobiquité Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le terme de mobiquité inventé par Xavier Dalloz est né de la fusion des mots mobilité et ubiquité. Il correspond au concept d'ATAWAD (AnyTime, AnyWhere, AnyDevice), une marque déposée par Xavier Dalloz. On parle aussi parfois de mobilité+ Droit de mobiquité[modifier | modifier le code] L'internaute peut commencer par exiger un droit de mobiquité en particulier sur les biens immatériels achetés. Liens externes[modifier | modifier le code] Article du blog de Francis Pisani sur la mobiquité Notes et références[modifier | modifier le code] Portail des télécommunications
web 4.0 Environnement pervasif Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Un environnement pervasif (ou environnement ubiquitaire) correspond à un fonctionnement global de la communication où une informatique diffuse permet à des objets communicants de se reconnaitre entre eux et de se localiser automatiquement. Principes[modifier | modifier le code] Les objets interagissent entre eux, avec ou sans action particulière de l'utilisateur humain. Autrement dit, à condition de disposer d'interfaces adaptées au système informatique, on peut être connecté partout et tout le temps. L'environnement ubiquitaire numérique sous-entend la notion de pro-activité, c'est-à-dire que des processus peuvent envoyer de l'information à ces terminaux à cœur numérique et en obtenir sans action d'un utilisateur. Droit, commerce, éthique[modifier | modifier le code] Ces possibilités nouvelles posent des questions nouvelles. Voir aussi[modifier | modifier le code] Sur les autres projets Wikimedia : pervasif, sur le Wiktionnaire
Web3D Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le Web3D correspondait initialement au concept d'un Web totalement en 3D, des hyperliens reliant les contenants entre eux. Par extension, le terme désigne aujourd'hui tous les contenus en 3D interactive qui sont intégrée à des pages HTML, et que l'on peut visualiser par l'intermédiaire de son navigateur Web. Soit : « la 3D sur le Web ». En 2009, les navigateurs requièrent l'installation d'un plugin pour afficher ce type de contenus. Les technologies actuelles du web 3D permettent, au-delà de simples sites en 3D, le développement futur de jeux en 3D en ligne, notamment des jeux massivement multijoueurs directement jouables dans le navigateur. Formats disponibles[modifier | modifier le code] Parmi les nombreux formats et modes d'intégration disponibles, on peut citer : Notes et références[modifier | modifier le code] Voir aussi[modifier | modifier le code] Articles connexes[modifier | modifier le code] Liens externes[modifier | modifier le code]
SixthSense Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Projet en cours de développement en 1998[1] L'invention s'appelle "aremac"[2]. Le projet SixthSense (« sixième sens »), parfois dénommé WUW pour Wear ur world, est un projet d'ordinateur ubiquitaire et dématérialisé. Ce projet est en cours de développement au MIT par Steve Mann, Pranav Mistry et Pattie Maes au MIT Media Lab et a été présenté en 2001[2]. Ce projet était intitulé à l'origine Synthetic Synesthesia of the Sixth Sense[3],[4]. Il s'agit d'un système logiciel et d'interfaces permettant de transformer des objets de l'environnement quotidien en des éléments d'un ordinateur semi-dématérialisé, qu'on emporte avec soi ; de nombreux objets deviennent supports possibles d'information ou d'interaction. Innovation[modifier | modifier le code] C'est un concept qui a rapidement attiré l'attention des médias spécialisés, mais aussi du grand public [5]. Principes[modifier | modifier le code] Objectifs[modifier | modifier le code] (en) P. (en) P.
Web des données Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Le Web des données (Linked Data, en anglais) est une initiative du W3C (Consortium World Wide Web) visant à favoriser la publication de données structurées sur le Web, non pas sous la forme de silos de données isolés les uns des autres, mais en les reliant entre elles pour constituer un réseau global d'informations. Il s'appuie sur les standards du Web, tels que HTTP et URI - mais plutôt qu'utiliser ces standards uniquement pour faciliter la navigation par les êtres humains, le Web des données les étend pour partager l'information également entre machines. Tim Berners-Lee, directeur du W3C, a inventé et défini le terme Linked Data et son synonyme Web of Data au sein d'un ouvrage portant sur l'avenir du Web sémantique[2]. Principes[modifier | modifier le code] Tim Berners-Lee a défini quatre piliers pour soutenir l'initiative « Web des données » : Notes et références[modifier | modifier le code] Références :
Bio-informatique Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. La bioinformatique est un champ de recherche multi-disciplinaire où travaillent de concert biologistes, médecins, informaticiens, mathématiciens, physiciens et bioinformaticiens, dans le but de résoudre un problème scientifique posé par la biologie. Depuis quelques années les progrès de l'informatique (et en particulier de la bioinformatique mise au service de la biodiversité ou « Biodiversity informatics » pour les anglophones) dopent la biologie évolutive en offrant aux chercheurs un accès à un nombre croisant de données sur la diversité et les variation des gènes, ainsi que des génomes, des organismes et de l'environnement en général. Le terme bioinformatique peut également décrire (par abus de langage) toutes les applications informatiques résultant de ces recherches[1]. Définitions et champs d'application[modifier | modifier le code] Analyse de séquence[modifier | modifier le code] Modélisation moléculaire[modifier | modifier le code]
WebOS Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Ne doit pas être confondu avec HP webOS (ou Palm webOS) Un WebOS (Web Operating System, en français Système d'exploitation sur le web) est une imitation de bureau ou environnement graphique d'un système d'exploitation. Articles connexes[modifier | modifier le code] Liens externes[modifier | modifier le code] OneEye Project, "a takeover of the legacy series one from the EyeOS project"Symbiose, un WebOS libre et open-sourceLucid, "a free, open source web desktop, or webOS"Fenestela, "un WebOS open-source"Zoho Office, suite bureautique en ligneUlteo Open Virtual DesktopuniverseOS, "first social WebOS"Zarmada Portail de l’informatique Knol sera t'il le futur du webmaster? Knol depuis son annonce dans le blog de Google, est un sujet de discussion dans les forums et sur les blogs, où il est présenté comme une alternative à Wikipedia, peut-être même comme un successeur. Qu'en est-il exactement? Mais Knol sera fermé en avril 2012. knol.google.com sera remplacé par une initiative décentralisée, en fait chaque auteur devra créer un compte sur Wordpress.com pour ses articles, ou utiliser son propre site Wordress avec Annotum, un thème spécialisé pour les sites collaboratifs. Knol selon Google Le titre de l'article "Encourageons les gens à partager leurs connaissances", démontre d'une part la volonté de fournir un système de diffusion efficace, d'autre part de donner au projet une nature encyclopédique et universelle. Le mot Knol est l'abréviation de Knowledge, (connaissance) et un Knol est un article d'une encyclopédie universelle: Contrairement à Wikipedia, les articles auront un auteur. "Knol fournira des outils communautaire efficaces. Conclusion Le Web nouveau
WolframAlpha Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Wolfram. Wolfram|Alpha (aussi écrit WolframAlpha lorsque Wolfram et Alpha sont dans deux couleurs distinctes) est un outil de calcul en langage naturel développé par la société internationale Wolfram Research. Il s'agit d'un service internet qui répond directement à la saisie de questions factuelles en anglais par le calcul de la réponse à partir d'une base de données, au lieu de procurer une liste de documents ou de pages web pouvant contenir la réponse. Son lancement a été annoncé en mars 2009 par le physicien et mathématicien britannique Stephen Wolfram et il a été lancé le 16 mai 2009 à 3 h 00 du matin. Wolfram|Alpha contient environ 10 milliards d'informations, plus de 50 000 types d'algorithmes et de modèles, et des capacités linguistiques pour plus de 1 000 domaines[1]. Utilisation[modifier | modifier le code] Les utilisateurs saisissent une question ou une demande de calcul.
Microformat Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Un microformat (parfois abrégé sous μF ou uF) est une approche de formatage de données dans des pages WEB[1] qui cherche à rationaliser et standardiser le contenu existant, comme les métadonnées, en utilisant des classes[2] et attributs de balises[3] XHTML et HTML. Cette approche est conçue pour permettre à l'information destinée aux utilisateurs finaux, telle que le carnet d'adresses, les coordonnées géographiques, les événements et autres données ayant une structure constante, d'être traitée automatiquement par les logiciels. Même si le contenu des pages web était déjà capable techniquement d'être « traité automatiquement » depuis la conception du web, il existait certaines limites. Les microformats actuels permettent l'encodage et l'extraction d'événements, d'information de contact, de relations sociales et ainsi de suite. Historique[modifier | modifier le code] Ni CommerceNet ni Microformats.org ne sont un corps de standards.
Web sémantique Logo du W3C pour le Web sémantique Le Web sémantique, ou toile sémantique[1], est une extension du Web standardisée par le World Wide Web Consortium (W3C)[2]. Ces standards encouragent l'utilisation de formats de données et de protocoles d'échange normés sur le Web, en s'appuyant sur le modèle Resource Description Framework (RDF). Le web sémantique est par certains qualifié de web 3.0 . Alors que ses détracteurs ont mis en doute sa faisabilité, ses promoteurs font valoir que les applications réalisées par les chercheurs dans l'industrie, la biologie et les sciences humaines ont déjà prouvé la validité de ce nouveau concept[5]. Histoire[modifier | modifier le code] Tim Berners-Lee à l'origine exprimait la vision du Web sémantique comme suit : I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing all the data on the Web — the content, links, and transactions between people and computers. — Tim Berners-Lee, Weaving the Web[13] — Weaving the Web[13]