


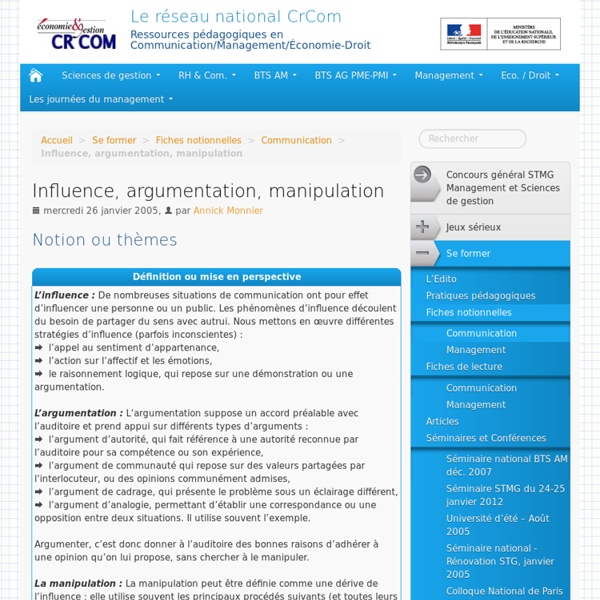
6 styles de leaders et leurs impacts sur leurs équipes de travail. Le leadership directif “Fais ce que je te dis” Cela pourrait être la phrase qui résume le leader directif. Très axé sur l’autorité et l’exécution immédiate de la tâche, il est moins sur les relations humaines et la vision globale. Vu comme le style de leadership archaïque, ce dernier est utilisé lors de crise, au moment où il faut des résultats concrets très rapidement ou encore avec certains collaborateurs plus “perturbateurs” (qui vont à l’encontre des consignes ou qui sont dans le présentéisme). Le leadership chef de file Tout aussi minutieux que le leader directif, le leader-chef de file va donner le tempo aux équipes de travail. Il peut se montrer moins patient avec certaines personnes moins performantes. Ce type de leadership fonctionne donc mieux avec des équipes qui sont déjà compétentes et qui connaissent bien leurs affaires ! Le leadership participatif Le leader participatif va mettre de l’avant l’intelligence collective. Le leadership visionnaire Le leadership coach
Comment l’extension de la communication bouleverse l’éthique et l’argumentation « Être déçu par ce à quoi on espérait conférer le rôle de fondement fait partie des risques du métier de philosophe. » Isabelle Stengers, L’invention des sciences modernes. 1Nombreux sont ceux qui soulignent l’importance prise aujourd’hui par la communication au détriment de l’information. 2Par ailleurs, la communication transforme même l’information. 3Le mouvement par lequel la communication tend à supplanter l’information jusqu’à la transformer se répercute sur d’autres plans. 4L’information et la communication ne découlent pas des mêmes à priori et n’ont pas les mêmes incidences ontologiques. 5L’information procède d’un principe réaliste. 1 Une information peut porter sur une autre information. 6On peut marquer ce trait, en disant que l’information est munie d’intentionnalité. 2 Cette recherche s’inscrivait dans la perspective plus large d’une critique du constructivisme en j (...) 3 Il y aurait à ce propos une hypothèse historique à étayer : la démarche scientifique peut émerger, (...)
De l’argumentation entre les visées d’influence de la situation de (...) - Patrick Charaudeau Version imprimable Il semblerait que l’on n’ait plus grand chose de nouveau à dire sur l’argumentation, depuis son origine aristotélicienne en passant par la nouvelle rhétorique de Perelman jusqu’à nos jours où la rhétorique argumentative connaît un certain regain [1]. Nous disposons de suffisamment de catégories pour les utiliser comme instruments d’analyse des textes et en vérifier leur efficace. Alors, quoi dire de plus sur le plan théorique ? Deux questions cependant me semblent devoir faire l’objet d’une attention particulière : l’une concerne le rapport de l’argumentation à la logique, l’autre, le rapport de l’argumentation à la pratique sociale. Dans le premier cas, il s’agit de procéder à la réorganisation des catégories du raisonnement. N’ayant pas le temps de développer ces deux points, c’est du second dont je vais traiter dans cette communication. 1. L’argumentation comme pratique sociale s’inscrit également dans une situation de communication. Problématiser Se positionner 2. 3.
Comment un individu devient-il acteur dans une organisation ? - Réviser le cours - Sciences de gestion L'individu, qui possède des caractéristiques propres, devient un acteur au sein de l'organisation par les relations formelles et informelles qu'il établit dans son activité de travail. Il communique et interagit donc en permanence, en cherchant non seulement à affirmer son individualité mais également à s'inscrire dans l'action collective. C'est en partie de cette tension que naissent les phénomènes relationnels au sein des organisations. 1. La personnalité Il s'agit de l'ensemble des caractéristiques spécifiques d'un individu. Les émotions On distingue six émotions de base : la peur, la joie, le dégoût, la colère, la surprise et la tristesse. La perception La perception est le processus par lequel l'individu interprète et donne une signification aux sensations ressenties par l'intermédiaire de ses cinq sens (la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher). Le lien entre attitude et comportement L'attitude est la prédisposition à réagir à une situation donnée. 2. 3. 4. 5. À retenir
Stéréotypes : Définition et caractéristiques Stéréotypes : Définition et caractéristiques 1. Stéréotype et préjugés Le préjugé peut être défini comme une « attitude de l’individu comportant une dimension évaluative, souvent négative, à l’égard de types de personnes ou de groupes, en fonction de sa propre appartenance sociale. Le préjugé a deux dimensions essentielles : l’une cognitive, l’autre comportementale. Le stéréotype, quant à lui, « désigne les catégories descriptives simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui ou des groupes d’individus » (Fischer, 1987) Les stéréotypes correspondent donc à des traits ou des comportements que l’on attribue à autrui de façon arbitraire. 2. La notion de stéréotype apparaît dans le domaine des sciences sociales avec le développement de la théorie des opinions. Walter Lippman utilisa, en 1922, le terme de stéréotype pour rendre compte du caractère à la fois condensé, schématisé et simplifié des opinions qui ont cours dans le public. 3. Source : Cours de Psychologie Sociale - Dijon
[Intelligence Collective] La théorie de la Dissonance cognitive Par Philippe Mougel,Sociologue cognitif, chef de projet à Welience et par Aurélien Trioux, chargé de mission « Mobilité et Territoire », Octobre 2010 Léon Festinger (1993), qui fut un étudiant de kurt Lewin, trouva avec ses associés un article dans le journal local intitulé « La prophétie de la planète Clarion, lance un appel à la ville : Fuyez cette inondation ! ». Ainsi la dissonance entre l’annonce du déluge et son échec a été réduite par un travail de ré-interprétation des messages « divins » et par une intense activité de prosélytisme. De la sorte, paradoxalement, une croyance contredite par d’autres éléments d’information devient souvent plus forte, car elle donne lieu à une intense activité de recherche d’éléments consonants, comme le font par exemple les convertis. Festinger a décrit comment l’individu rationalise ses cognitions pour expliquer ses conduites et pour éviter l’état de dissonance cognitive. - la première comme conséquence de décisions prises, - 1. - 2. - 3. - 4.
L'argumentation Fiche à destination de l’enseignant I. Notions générales : L’argumentation appartient à la famille des actions humaines qui ont pour objectif de convaincre. Les différents registres de la communication Source : Philippe Breton, "l’argumentation dans la communication", Editions Repères. La manipulation psychologique, largement utilisée pour convaincre, relève d’une violence exercée. Ainsi l’argumentation ne relève pas d’une science exacte, ni n’en constitue une, même si elle emprunte des modèles. L’argumentation implique un émetteur - on l’appelle ici l’orateur (terme plus général) - un message constitué par l’opinion mise en forme en vue de convaincre et un récepteur - le public, appelé ici le plus souvent l’auditoire. Savoir argumenter n’est pas un luxe, mais une nécessité. II Le champ de l’argumentation : L’exercice n’est pas simple : le bon usage de l’argumentation implique une rupture avec l’univers des techniques de manipulation. Le triangle argumentatif : l’orateur, celui qui argumente.
Sommes-nous câblés pour argumenter Cette irrationalité inhérente à l'esprit humain, dont nous avons déjà présenté plusieurs aspects dans nos colonnes, d'où vient-elle ? Si la raison a été réellement développée pour nous permettre de résoudre des problèmes complexes, elle aurait dû se montrer plus efficace. C'est le lièvre que soulève un article du New Scientist (réservé aux abonnés, mais ses sources sont disponibles en ligne). La réponse la plus évidente est que la raison n'a pas pour but de trouver des solutions. Le raisonnement sert-il d'abord à convaincre ? Fondamentalement, nous explique-t-on, l'homme est un animal social dont l'intelligence a évolué au sein d'un groupe. Afin de l'emporter dans le débat, certains biais propres à notre fonctionnement mental se seraient particulièrement développés. Un autre exemple cité par le New Scientist est la façon dont nous sommes sensibles à la manière dont les arguments sont présentés. Des biais innés ? D'où l'importance du travail avec les enfants. Rémi Sussan
Communication interne, politesse et rituels sociaux A partir d'analyses diverses, en particulier celles de Jean-Pierre Le Goff, sociologue des entreprises et auteur de La Barbarie douce et de Les illusions du management, le texte insiste sur les erreurs d'interprétation que les salariés risquent de faire face à des relations où la hiérarchie ne semble, à priori, plus compter et où une certaine proximité entraîne une illusion égalitaire. Le sociologue pose quelques bases historiques en rappelant les modèles "open space" ou "start-up". Ce dernier, posé en idéal organisationnel, ayant été à l'origine d'ambigüités dévastatrices : « Sous ces différentes influences les entreprises sont passées d'un excès à un autre en remplaçant un modèle hyper-vertical et hiérarchique par une utopie de management totalement horizontal, donc égalitaire ». De temps en temps, on se demande comment relancer sa communication interne, lui donner un nouveau souffle.
Les 7 tendances qui redessinent la vie des (en) entreprises Les signaux ne sont plus faibles : nous observons des tendances fortes. Tout porte à croire que nous vivons un changement de paradigme. Évolutions sociétales, révolution digitale, postmodernité, évolution des métiers et restructuration de l’emploi, organisation systémique, qualité de vie… c’est un nouveau contrat social qui est en train d’émerger. Le monde, la société, l’entreprise, le management en seront affectés. Il est à mon avis possible de discerner 7 grandes tendances qui impactent aujourd'hui, à un degré ou à un autre, toute activité relationnelle entre les êtres humains au travail : 1) Un ensemble d’évolutions sociétales, affectant fortement les mentalités. 2) La “révolution digitale” n’est pas d’abord une question de technologie, mais de nouveaux modes de collaboration et de coopération. 3) Les tâches d’exécution sont tôt ou tard destinées à être automatisées. Ces 7 tendances se potentialisent pour créer un effet de mutation profonde Nous souhaitons recueillir vos avis !
Influence et Manipulation : 6 techniques pour comprendre les mécanismes de persuasion Temps de lecture estimé : 8 minutes Vous êtes-vous déjà surpris à dire « oui » à un vendeur puis de vous demander pourquoi vous venez d’accepter quelque chose que vous ne voulez pas vraiment ? Dans Influence et Manipulation, un grand classique de la psychologie sociale, Robert Cialdini présente six principes d’influence employé par des vendeurs pour nous inciter à dire oui. Comme le disait Alfred North Whitehead, « La civilisation avance en étendant le nombre d’opérations que nous pouvons effectuer sans réfléchir. » Il en est de même pour le cerveau humain qui façonne des raccourcis pour préserver son énergie pour sa survie et le traitement de nouvelles informations. En sachant identifier les techniques employés par les manipulateurs, vous saurez non seulement vous en préserver, mais aussi être une personne plus réfléchie. Dans cet article, vous allez découvrir : 1. La règle dit que nous devrions essayer de rembourser, en nature, ce que l’autre personne nous a fourni. La concession réciproque
Identité (sciences sociales) Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Pour les articles homonymes, voir Identité. L’identité de l'individu est, en psychologie sociale, la reconnaissance de ce qu'il est, par lui-même ou par les autres. La notion d'identité est au croisement de la sociologie et de la psychologie, mais intéresse aussi la biologie, la philosophie et la géographie. Erik Erikson conçoit l'identité comme une sorte de sentiment d'harmonie : l'identité de l'individu est le « sentiment subjectif et tonique d'une unité personnelle et d'une continuité temporelle » (1972). Dans la tradition freudienne, l'identité est une construction caractérisée par des discontinuités et des conflits entre différentes instances (le Moi, le Ça, le Surmoi, etc). Jean Piaget insiste sur la notion de socialisation de l'individu à travers une intériorisation des représentations sociales, principalement par le langage[1]. Dans son acception numérique, l’identité répond à une perspective essentialiste.