


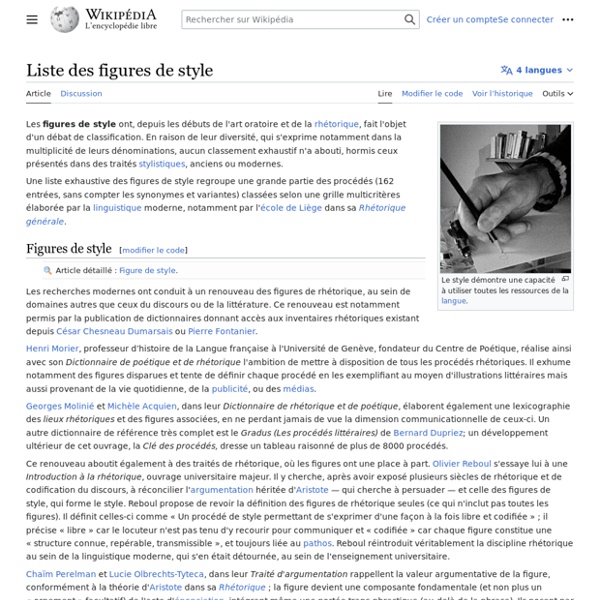
Effet Koulechov Définition[modifier | modifier le code] Histoire[modifier | modifier le code] Il ne reste aucune trace matérielle de l’expérience de Koulechov, en termes de négatif ou de copies, même pas un simple photogramme extrait du film. En revanche, Vsevolod Poudovkine, crédité de cette expérience (par ses soins ou par la rumeur publique, nul ne le sait), en se présentant lui-même comme un grand théoricien du montage (mais il a par la suite rendu à Koulechov la paternité de l’expérience), a tout fait pour qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui : un mythe, répandu non seulement dans les milieux professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, mais aussi dans ceux des amoureux du cinéma et de la critique de films grand public. L’historien du cinéma Vincent Pinel note encore que « d’autres descriptions ont été données de cette expérience avec des variantes thématiques… les photographies publiées beaucoup plus tard étant visiblement apocryphes[4]. » L’effet Koulechov, mythe ou réalité ? (en) Davi G.
Rhétorique Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Au-delà de cette définition générale, la rhétorique a connu au cours de son histoire une tension entre deux conceptions antagonistes, la rhétorique comme art de la persuasion et la rhétorique comme art de l'éloquence. La rhétorique grecque, telle qu'elle fut pratiquée par les sophistes et codifiée par Aristote, se préoccupait principalement de persuader. Dans l'Antiquité romaine, se fait jour une nouvelle conception de la rhétorique comme art de bien dire « bene dicendi scientia » selon les mots de l'orateur romain Quintilien[2]. A l'époque classique, la rhétorique s'étend à l'étude des textes écrits, et notamment aux textes littéraires et dramatiques, la conception romaine de la rhétorique l'emporte progressivement sur la conception grecque. Problématiques de la rhétorique[modifier | modifier le code] Polémiques autour d'une définition[modifier | modifier le code] Rhétorique et argumentation[modifier | modifier le code] Pour J.
Discours épidictique Le discours épidictique (dénomination grecque) ou discours démonstratif (dénomination latine) est un registre qui fait partie des trois genres de discours distingués par Aristote[1]. Longtemps en retrait des deux autres genres, il connaît sous la forme d'éloge un grand succès sous l'Empire romain. Définition[modifier | modifier le code] Le discours épidictique (en grec : epideiktikon, en latin demonstratiuum) loue ou blâme. Lorsqu'il loue, ce genre est aussi nommé laudatif (en grec : enkômiastikon, en latin laudatiuum) ou panégyrique (en grec : panêgurikon, en latin panegyricuum)[2]. Parfois au détriment de la vérité et de l'objectivité, le registre épidictique concerne les objets les plus divers : personne, cité, dieu, animal ou objet inanimé, sujets qui déterminent sa composition[3]. Il est souvent présent dans les portraits, donnant lieu à une idéalisation du modèle ou à sa caricature. Historique[modifier | modifier le code] Les procédés récurrents[modifier | modifier le code]
Ironie Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. L’ironie désigne un décalage entre le discours et la réalité, entre deux réalités ou plus généralement entre deux perspectives, qui produit de l'incongruité. L'ironie recouvre un ensemble de phénomènes distincts dont les principaux sont l'ironie verbale et l'ironie situationnelle. Quand elle est intentionnelle, l'ironie peut servir diverses fonctions sociales et littéraires. L'ironie verbale[modifier | modifier le code] Éléments de définition[modifier | modifier le code] L’ironie verbale est une forme de langage non-littéral, c'est-à-dire un énoncé dans lequel ce qui est dit diffère de ce qui est signifié. L'antiphrase ironique. « Quelle belle journée ! « Je suis carrément mort de rire… » venant d'un locuteur à qui l'on a fait une plaisanterie douteuse. La litote ironique qui consiste au contraire à minimiser ses propos. « Il n’est pas complètement stupide » à quelqu’un qui vient de résoudre un problème compliqué. « Beau temps, n'est-ce pas ?
Effet de domination asymétrique Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. En marketing, l'effet de leurre (ou l'effet d'attraction ou l'effet de domination asymétrique) est le phénomène par lequel les consommateurs ont tendance à avoir un changement spécifique de préférence entre deux options lorsqu'on leur présente une troisième option étant asymétriquement dominée[1]. Une option est asymétriquement dominée lorsqu'elle est inférieure à tous égards à une option; mais, comparée avec une autre option, elle est inférieure sur certains points, supérieure sur d'autres. En d'autres termes, en matière d'attributs spécifiques à la détermination des préférences, elle est complètement dominée par (c'est-à-dire inférieure à) une option et seulement partiellement dominée par l'autre. Lorsqu'une option asymétriquement dominée est présente, un pourcentage plus élevé de consommateurs préfèrent davantage l'option dominante que lorsque l'option asymétriquement dominée est absente. Exemple[modifier | modifier le code]
Poétique (Aristote) La Poétique (en grec : Περὶ ποιητικῆς / Perì poiêtikês, « De la poétique ») est un ouvrage d’Aristote portant sur l'art poétique et plus particulièrement sur les notions de tragédie, d’épopée et d’imitation. Il a probablement été rédigé autour de 335 av. J. Par de nombreuses allusions au fil du texte et d'autres indices, il semble que la Poétique telle qu'elle est parvenue n'est pas complète, plusieurs études, notamment sur la comédie, sont perdues. Le plan de la Poétique d'Aristote n'est pas toujours parfaitement cohérent et facile à déterminer. Dans les chapitres 1 à 5, Aristote introduit les catégories et concepts grâce auxquels il classe et analyse les différentes formes de productions poétiques ; il classe ainsi ces dernières en fonction : de la façon dont elles représentent leur objet (est-ce qu'elles représentent leur objet comme il est, en mieux ou en pire ?) C'est sur ce point qu'Aristote se sépare de Platon. « [...] « [...] . Aristote (trad.
Schéma actantiel Un personnage, le héros, poursuit la quête d'un objet. Les personnages, événements, ou objets positifs qui l'aident dans sa quête sont nommés « adjuvants ». Les personnages, événements ou objets négatifs qui cherchent à empêcher sa quête sont nommés « opposants ». La quête est commanditée par un émetteur (ou destinateur, ou énonciateur — voir l'article énonciation), au bénéfice d'un destinataire. Dans le schéma actantiel de Greimas, les rôles actantiels, c'est-à-dire, à proprement parler, les « actants », ne doivent en aucun cas être confondus avec des « acteurs ». le sujet et l'objet sont situés sur l'axe du désir (ou de la quête) ;le destinateur et le destinataire sont situés sur l'axe de la communication ;les adjuvants et les opposants sont situés sur l'axe du pouvoir (pouvoir positif dans le cas des adjuvants, négatif dans le cas des opposants). Le schéma actantiel doit être complété par la théorie des trois épreuves, ou étapes formelles, de tout récit (sur un axe temporel) :
Hyperbole Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sur les autres projets Wikimedia : hyperbole, sur le Wiktionnaire Le terme hyperbole vient du grec hyperbolê, de hyper, qui signifie « au-delà », et ballein, qui signifie « jeter » : Motives for spying There are many motives for spying. Espionage usually carries heavy penalties, with spies often being regarded as traitors, so motivating factors for it must usually be quite strong. There have been various attempts to explain why people become spies. One common theory is summed up by the acronym MICE: Money, Ideology, Compromise or Coercion (depending on source), and Ego or Extortion (depending on source). Another is the RASCLS framework: Reciprocation, Authority, Scarcity, Commitment and Consistency, Liking, and Social Proof.[1] Others have stressed the roles of disaffection, grudges, and personal links. Money[edit] For many spies, the primary motivation is the prospect of financial gain. Ideology, patriotism, or religion[edit] Some people become spies because of their beliefs. Coercion[edit] Not all spies enter into service willingly; sometimes they are threatened into providing secret information. Threats of injury or death are the most direct forms of coercion. Self-importance[edit]
Horace Biographie[modifier | modifier le code] La vie d'Horace nous est essentiellement connue par son œuvre, riche en informations et considérée comme une source fiable[1]. Quelques renseignements supplémentaires figurent dans la biographie De viris illustribus (Des hommes illustres) de Suétone. Famille et enfance[modifier | modifier le code] « Si [...] ma vie est pure et innocente, mes jours chers à mes amis, le mérite en appartient à mon père qui, tout pauvre qu'il était, possesseur d'un maigre champ, ne voulut pas toutefois m'envoyer à l'école de Flavius, où allaient pour quelque argent, payé au retour des ides, avec leur bourse à jetons et leurs tablettes sous le bras gauche, les nobles fils de nos nobles centurions. — Satires, I, 6, vers 71-77 En Grèce[modifier | modifier le code] Virgile (à gauche) déclamant ses vers devant Horace (au milieu), Varius (au fond) et Mécène (à droite) par Charles François Jalabert. Retour à Rome[modifier | modifier le code] Maturité[modifier | modifier le code]
Mémoire culturelle La mémoire culturelle désigne les souvenirs et les expériences immortalisés par les médias et les rites commémoratifs. En tant que concept, la mémoire culturelle est introduite pour la première fois en 1997 par l'égyptologue allemand Jan Assmann dans son ouvrage Das Kulturelle Gedächtnis. Dans son livre, Assmann reprend puis dépasse la théorie de mémoire collective proposée par le sociologue franco-allemand Maurice Halbwachs pour élaborer le concept de mémoire communicationnelle (souvenirs et expériences transmis oralement et de façon informelle de génération en génération) et de mémoire culturelle, cette dernière permettant notamment de construire des récits sur les origines avec non pas des événements historiques mais des « mnémohistoires » (Gedächtnisgeschichte, histoires des souvenirs)[1]. Notes et références[modifier | modifier le code] ↑ Tristan Landry, La mémoire du conte folklorique de l'oral à l'écrit, Presses Université Laval, 2006, p. 11 Annexes[modifier | modifier le code]
Gradation Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. anc Cet article concerne une figure de style. Pour les degrés de l'adjectif et de l'adverbe, voir Degré de comparaison. Exemples[modifier | modifier le code] « Sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, Définition[modifier | modifier le code] Passage progressif et par degrés d'une chose à une autre. Définition linguistique[modifier | modifier le code] La gradation est la disposition de termes non identiques dans un ordre de valeur croissant ou décroissant. À tort, on considère parfois que la gradation n'est qu'ascendante[1]. Comme dans toutes les classifications, on constate des cas à double appartenance. « Ma reine, ma femme, mon amour » (voir dans les exemples ci-dessus). Définition stylistique[modifier | modifier le code] La gradation est une figure très employée en littérature et à l'oral; elle permet : Elle est très employée dans les descriptions et hypotyposes. Genres concernés[modifier | modifier le code]
Syndrome de Münchhausen Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Les patients atteints de ce syndrome présentent de multiples cicatrices d'opérations à la suite d'hospitalisations répétées pour des affections simulées. Ils sont volontiers querelleurs, voire agressifs, s'ils n'obtiennent pas l'attention souhaitée. Le syndrome est classé en tant que « trouble factice avec symptômes physiques ». Les troubles provoqués volontairement les plus fréquents incluent convulsions, saignements dus à la prise d'anticoagulants, vomissements et diarrhées ainsi que fièvre et éruptions cutanées. Le syndrome de Münchhausen est lié au syndrome de Münchhausen par procuration, dans lequel un individu blesse volontairement un autre, notamment un enfant, dans le but d'obtenir de l'attention. Histoire[modifier | modifier le code] Le nom de ce syndrome dérive du baron de Münchhausen (1720-1797), un militaire allemand auquel sont attribués des exploits invraisemblables rapportés par Rudolph Erich Raspe.